
[English Version] [Versión en español]
Dans son dernier livre, Leadership : Six Studies in World Strategy, Henry Kissinger a rédigé une étude sur six dirigeants nationaux : Konrad Adenauer (République fédérale d'Allemagne), Charles de Gaulle (France), Richard Nixon (États-Unis), Anwar Sadat (Égypte), Lee Kuan Yew (Singapour) et Margaret Thatcher (Royaume-Uni). Comme le sous-titre le suggère, il s'agit de six études sur la stratégie mondiale.
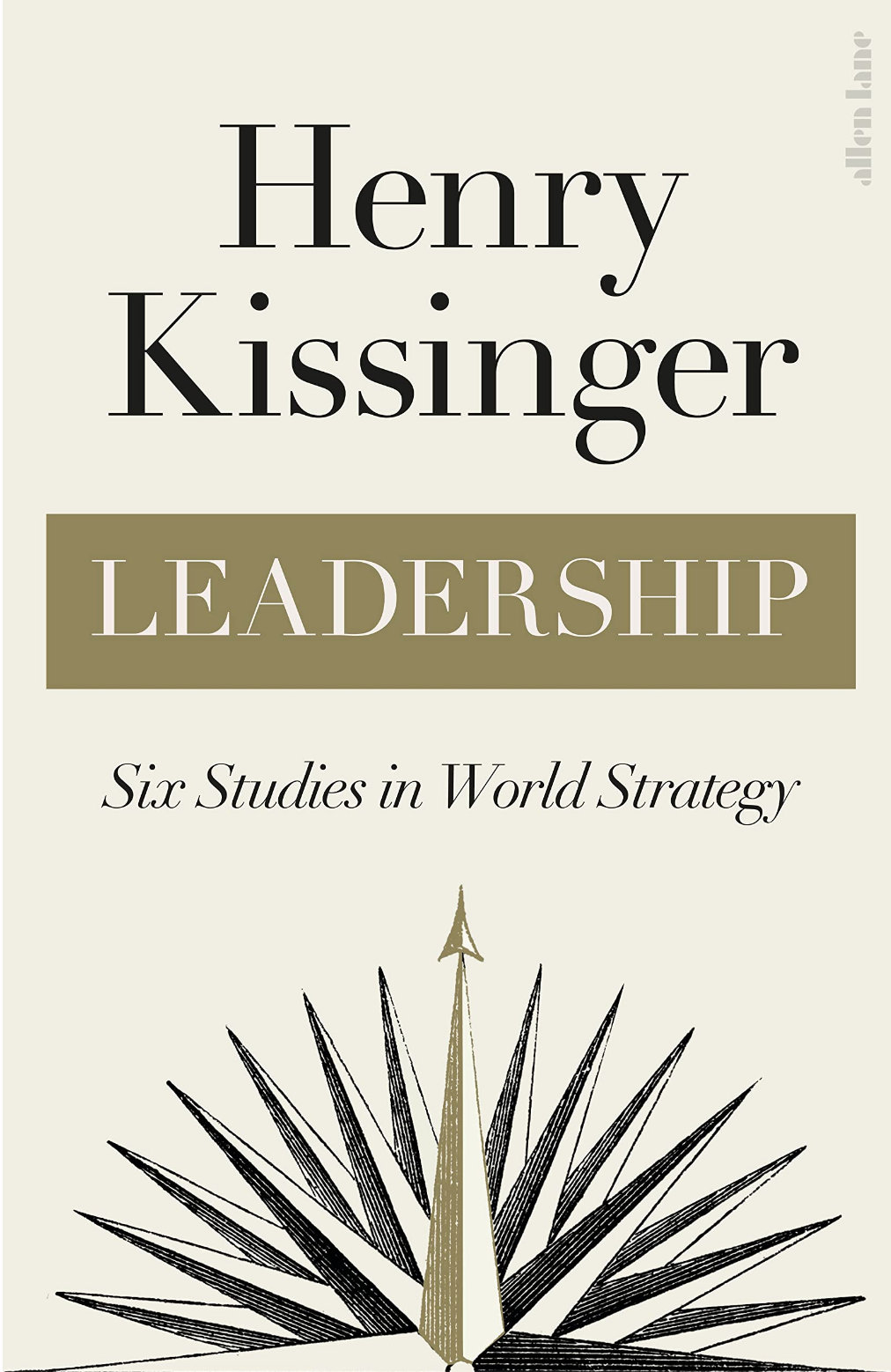
Tous ont été connus de Kissinger ou ont eu des relations avec lui, en particulier Richard Nixon, avec qui il était conseiller à la sécurité nationale et secrétaire d'État. Au cœur de sa perspective politique se trouve la notion de stratégie, et celle-ci est à son tour informée par un concept d'intérêt national et de relations de pouvoir qui n'a pas beaucoup changé depuis le milieu du 17e siècle et le règlement westphalien. Bien sûr, la façon dont les stratégies se déroulent dans le monde réel, et dans quelle mesure les plans les mieux conçus sont remis à plus tard, est une question d'interprétation créative ou de révision historique. Chaque leader représente une "stratégie" basée sur les antécédents du leader.
La stratégie d'Adenauer, selon Kissinger, était "l'humilité". Adenauer préconise que l'Allemagne avance prudemment vers la restauration de sa souveraineté et sa réunification après la Seconde Guerre mondiale en contribuant activement au développement et à la participation aux institutions européennes. Une telle stratégie s'oppose à d'autres options impulsives et populistes. Mais Adenauer peut difficilement être considéré comme "humble" dans ce qu'il recherchait, car il voulait un retour à la respectabilité et à la responsabilité pour l'Allemagne et ses intérêts. Comme l'illustre Kissinger, Adenauer était une personne fière, calculatrice, dotée de principes et courageuse, qui utilisait l'humilité pour obtenir ce qu'il voulait, de manière rusée.
Kissinger, à partir d'une position privilégiée (et donc à la fois d'une présomption d'exactitude et d'une certitude intéressée), dépeint Nixon comme quelqu'un pour qui les manœuvres stratégiques prennent généralement le pas sur les considérations morales. Nixon représente la stratégie de l'"équilibre". Kissinger attribue à Nixon la quête d'un monde "multipolaire" dans lequel les grandes puissances parviennent à la paix par l'équilibre plutôt que par la supériorité, dans un développement du réalisme dans les relations internationales et une adaptabilité aux circonstances. Kissinger ne rend cependant pas suffisamment compte des dommages infligés par Nixon à ses propres initiatives et à sa réputation. Il traite le Watergate comme une "tragédie". Nixon a réussi à ouvrir des relations avec la Chine, ainsi qu'à conclure quelques accords notables de contrôle des armements. Mais plusieurs de ses initiatives ont échoué : le Vietnam a été une erreur coûteuse, malgré quelques succès temporaires dans les négociations ; l'administration a mal calculé les besoins de Sadate en 1973 et est entrée en guerre ; les efforts de Nixon pour obtenir l'"autonomie" du Bangladesh ont été rejetés par le premier ministre indien, Indira Gandhi ; et les accords de contrôle des armes de Nixon ont été sapés par l'effet du Watergate. De plus, la politique de la "Chine unique" et l'accent mis sur les démonstrations de force étaient des politiques d'Eisenhower, la différence entre Nixon et Eisenhower étant notée dans l'histoire : Eisenhower a fait sortir les États-Unis de Corée sur un accord favorable et durable. Bien sûr, lui, Kissinger, était là. Sur la question du Chili et de la position américaine, par exemple, dans ce pays d'Amérique latine en 1973, il vaut mieux ne pas en parler... et c'est ce que pense Kissinger : il vaut mieux ne pas en parler.
This post is for subscribers only
Subscribe now and have access to all our stories, enjoy exclusive content and stay up to date with constant updates.
Already a member? Sign in
